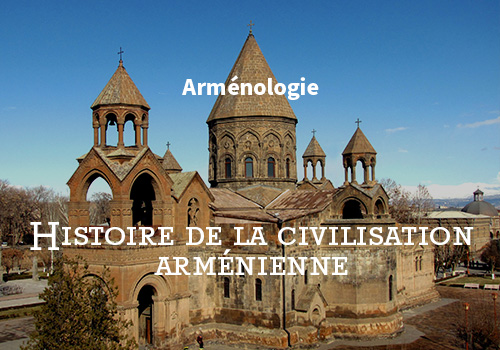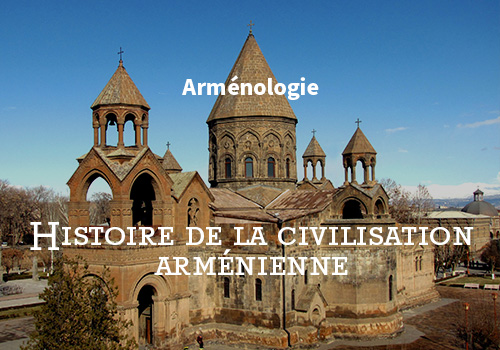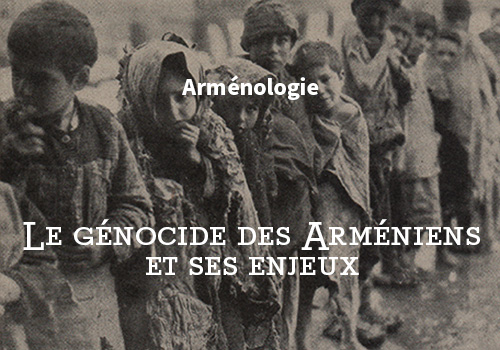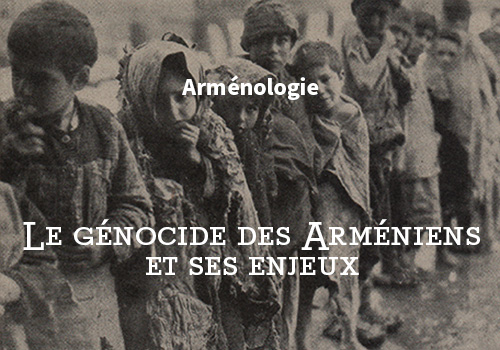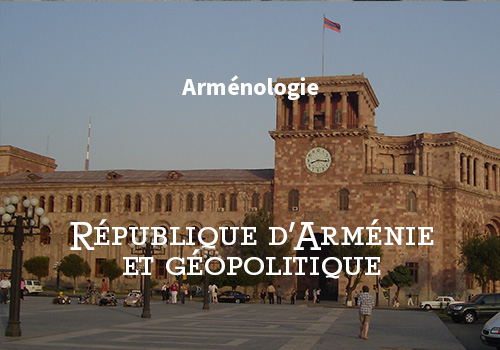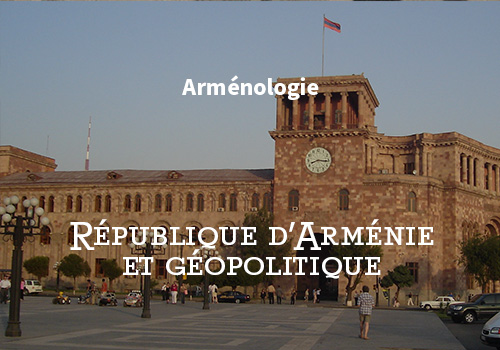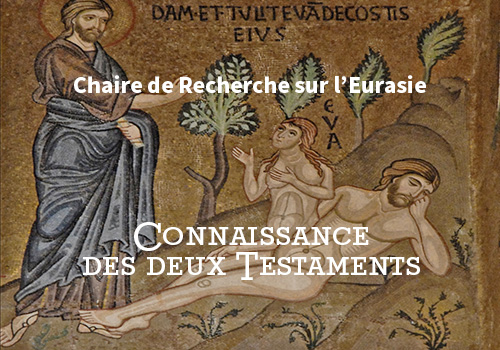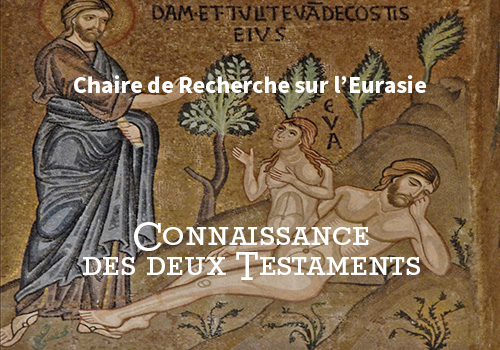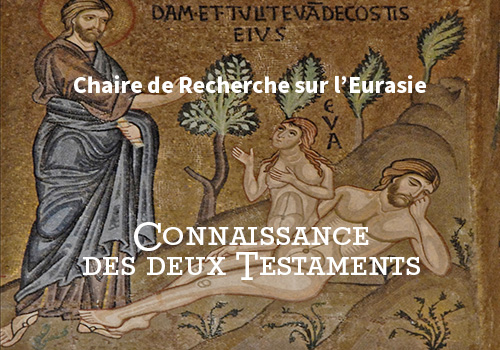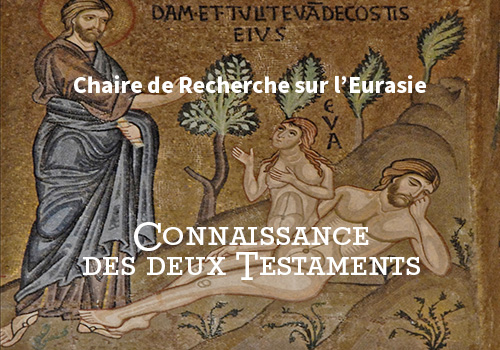Le christianisme arménien, socle identitaire millénaire et patrimoine mondial, est la cible d'un révisionnisme historique et d'une guerre informationnelle systématiques. Son histoire et ses monuments, notamment au Haut-Karabakh (Artsakh), sont menacés d'effacement par falsification, désinformation et destructions.
Face à cette menace, cette conférence se propose de :
- Sensibiliser à la richesse et à la vulnérabilité de cet héritage unique.
- Analyser les mécanismes du révisionnisme (négation, appropriation illégitime) et identifier ses acteurs étatiques ou autres.
- Décrypter les tactiques sophistiquées de la guerre informationnelle (propagande, désinformation ciblée, manipulation des médias sociaux).
- Évaluer les impacts profonds sur le patrimoine culturel, les droits humains des populations concernées et la stabilité géopolitique régionale.
- Explorer les stratégies de riposte : documentation scientifique rigoureuse, développement de contre-discours factuels, mobilisation du droit international et plaidoyer auprès des instances compétentes.
Les axes d'étude incluront : l'histoire et la spécificité du christianisme arménien comme enjeu mémoriel ; les manifestations concrètes du révisionnisme sur le terrain et en ligne ; les outils et vecteurs de la désinformation ; les enjeux juridiques et géopolitiques liés à la protection du patrimoine en péril ; et les initiatives de préservation et de défense de la vérité historique. Cette conférence est essentielle pour comprendre les dynamiques actuelles de manipulation de l'histoire à des fins politiques et pour mobiliser les savoirs afin de défendre un patrimoine commun de l'humanité, vital pour l'identité arménienne et pour la mémoire collective universelle.
Quatre universitaires examineront les diverses facettes de cette question :
- Pierre Gueydier (Univ. Catho. de l’ouest), sur les politiques d’influence
- Remi Korman (Univ. Catho. de l’ouest), sur les politiques révisioniste
- Alain Navarra di Borgia (Univ. Bologne – Haystart), sur la préservation du patrimoine en zone de conflit
- Maxime Yevadian (CNRS Lab. Hisoma – Chaire d’Arménologie de Lyon) sur la patrimoine culturel arménien
- Enseignant: Maxime Yevadian